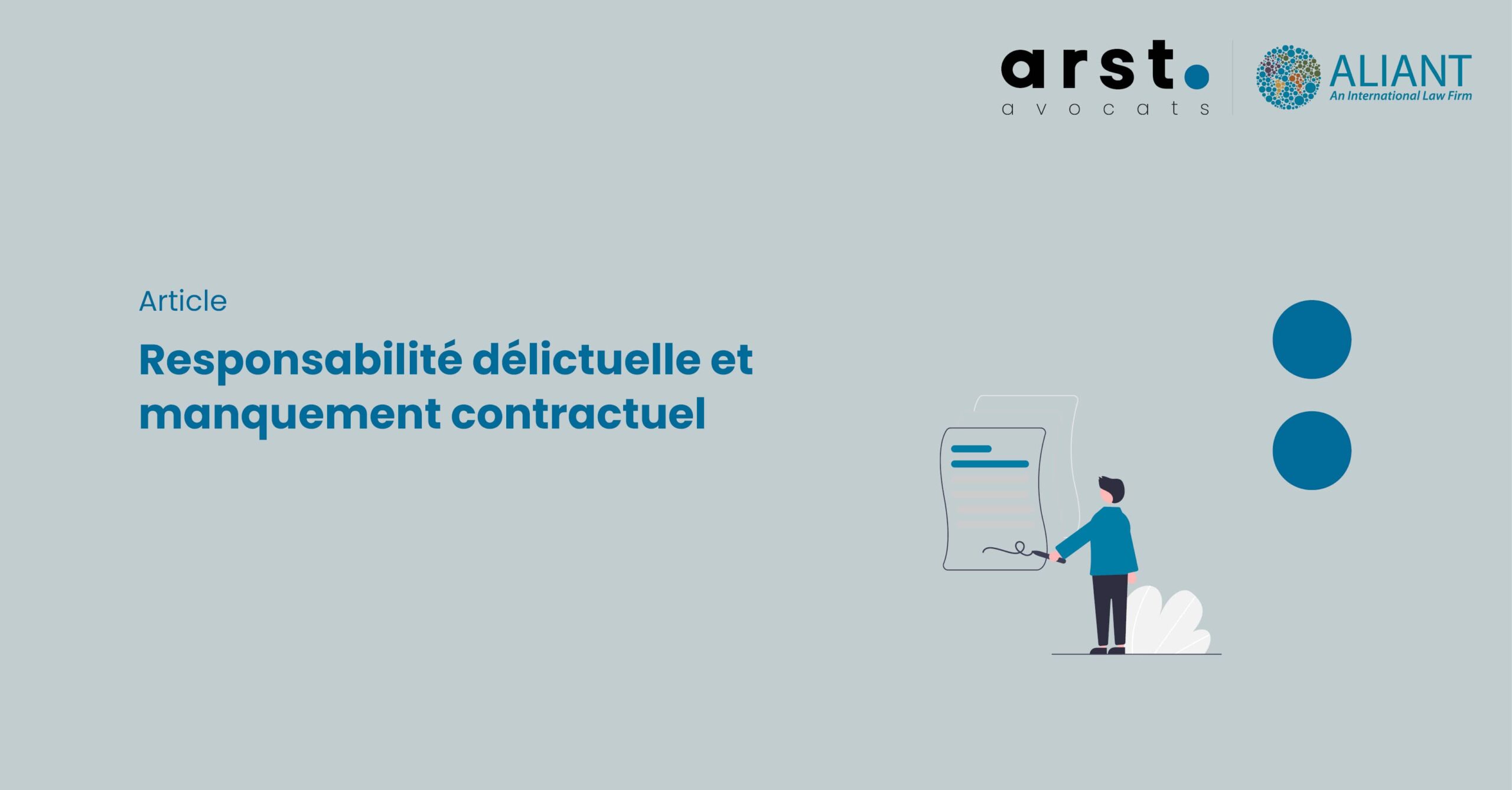
Dans le cadre de son arrêt « Boot’Shop » d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 (n°05-13.255), la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le tiers à un contrat peut demander réparation du préjudice qu’il subit du fait de la faute commise par l’un des cocontractants, sans qu’il ne soit exigé de démontrer l’existence d’une faute extracontractuelle distincte.
La doctrine a analysé cette décision comme une assimilation entre manquement contractuel et faute délictuelle, soulignant au passage qu’une telle solution permettrait aux tiers d’obtenir, au travers de dommages et intérêts, l’exécution par équivalent de contrats auxquels ils sont totalement étrangers, ce en totale contravention avec le principe de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du Code civil et selon lequel
les tiers ne peuvent [pas] demander l’exécution [du contrat]
Une certaine résistance semble s’être par la suite organisée au sein même de la Cour de cassation au travers de décisions imposant la preuve de la commission d’une faute délictuelle (3e Civ., 22 octobre 2008, n°07-15.692) ou refusant tout simplement de qualifier de faute délictuelle le manquement à une obligation contractuelle (par exemple, celle de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices : 3e Civ., 18 mai 2017, n°16-11.203). Ces arrêts ont ainsi pu être interprétés comme faisant barrage à la « jurisprudence Boot’Shop ».
Aux termes d’un arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, la Cour de cassation a fermement rappelé le principe selon lequel le tiers au contrat peut demander l’indemnisation des dommages causés par une faute contractuelle, sans autre condition que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage :
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Dans un contexte, qui semble être celui d’un retour à la solution « Boot’Shop », l’arrêt de la Chambre commerciale du 15 juin 2022, ici commenté, apporte un éclairage intéressant sur la nature du préjudice susceptible d’indemnisation.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, des héritiers agissaient en responsabilité délictuelle contre une banque et un assureur au motif que leur négligence à l’occasion du rachat d’un contrat d’assurance-vie avait conduit leur cliente, décédée depuis, à devoir emprunter afin de pouvoir rembourser un prêt in fine. En conséquence de cette faute, les héritiers réclamaient l’allocation de dommages et intérêts d’un montant représentant le solde du prêt in fine non couvert par le rachat litigieux, augmenté des intérêts afférents à la fois au prêt in fine et aux autres prêts souscrits par le de cujus pour faire face à son obligation de remboursement.
Sans surprise, la décision d’appel ayant débouté les héritiers est confirmée par la Chambre commerciale, qui relève en effet qu’en se prévalant des sommes dues par l’emprunteur lui-même, ce n’est pas d’un préjudice personnel dont il était question.
L’affaire aurait peut-être pris un autre tour si les demandeurs s’étaient prévalus du fait qu’en s’endettant pour solder son prêt in fine, le de cujus avait finalement diminué l’actif successoral, leur causant ainsi une sorte de manque à gagner. La question du caractère personnel de leur préjudice aurait alors probablement été évitée. Mais celle du caractère direct du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise par la banque et l’assureur aurait surgi car les deux étaient en réalité liés par quelque chose de totalement étranger aux uns et aux autres : le décès du de cujus. En effet, sans le décès de leur parente, le manque à gagner découlant de la dépréciation de l’actif successoral n’aurait probablement pas constitué un préjudice indemnisable. Si bien que l’on peut se demander si, pour les héritiers, la voie de l’action en responsabilité délictuelle est seulement possible dans le contexte d’une faute originelle de nature contractuelle.

Jefferson Larue
auteur
avocat associé

Lily Ravon
auteur
avocate
Répétition de prestations de vieillesse obtenues par fraude
Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai...
Prescription biennale : la Cour de cassation pose enfin des limites en faveur des assureurs
L’obligation d’information des assureurs quant aux causes d’interruption de la prescription biennale ne requiert pas de mentionner l’intégralité de l’article 2243 du code civil selon lequel l’interruption n’a pas lieu dès lors que le demandeur se désiste, laisse...
Entretien avec Romain Picard, jeune associé du cabinet Arst Avocats spécialisé en Corporate / M&A
Nous recevons aujourd’hui Romain Picard, jeune associé du cabinet Arst Avocats, qui nous expose les raisons l’ayant conduit à rejoindre celui-ci et nous parle des projets qui l’animent quant au développement de la pratique du Corporate / M&A dans ce cabinet...
Répétition de prestations de vieillesse obtenues par fraude
Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai...
Prescription biennale : la Cour de cassation pose enfin des limites en faveur des assureurs
L’obligation d’information des assureurs quant aux causes d’interruption de la prescription biennale ne requiert pas de mentionner l’intégralité de l’article 2243 du code civil selon lequel l’interruption n’a pas lieu dès lors que le demandeur se désiste, laisse...
Entretien avec Romain Picard, jeune associé du cabinet Arst Avocats spécialisé en Corporate / M&A
Nous recevons aujourd’hui Romain Picard, jeune associé du cabinet Arst Avocats, qui nous expose les raisons l’ayant conduit à rejoindre celui-ci et nous parle des projets qui l’animent quant au développement de la pratique du Corporate / M&A dans ce cabinet...